dimanche, 29 juin 2008
L'Acteur, La Parole, Le Lieu
entretien avec Fabrice Hadjadj
Le théâtre est né en Grèce. Il n’y a pas de théâtre juif. Où sont les racines d'un « théâtre chrétien » ?
C’est une question difficile : d’un côté, parce qu’elle porte sur les origines, de l’autre, parce qu’elle part de plusieurs affirmations ambiguës. D’abord, qu’il n’y aurait pas de théâtre juif. Non seulement la Bible contient une très haute puissance dramaturgique (ce qui explique les mystères du Moyen Âge, puis le théâtre renaissant, l'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, Saül le furieux de Jean de la Taille, Les Juifves de Robert Garnier, enfin Esther et Athalie), mais c'est aussi une vieille tradition juive que de monter des pièces durant le jour de Pourim, fête d'Esther où l’on célèbre l’échappée in extremis de l’extermination totale. Cette tradition est si forte qu'elle persista au milieu du désastre. Il y eut du théâtre dans le ghetto de Varsovie, et aussi dans la partie BIIB du camp d'Auschwitz, durant le court répit que connurent les déportés de Theresienstadt, avant de passer à la chambre à gaz. Je tiens à cette référence d’un théâtre juif, avec sa joie si singulière, forte de mélancolie, qui se déploie entre l’imminence du massacre et celle du Messie.
Pour ce qui est du « théâtre chrétien » (mieux vaudrait parler du théâtre en chrétienté), la chose est plus malaisée à définir. Surtout en France, où la bataille pour ou contre les comédies fit rage à l’heure de l’apogée du théâtre classique, de sorte qu’on put écrire qu'un tel théâtre en lui-même semblait antichrétien. Ce théâtre hérite des Grecs, notamment d’Euripide, et des fameuses règles de la Poétique d’Aristote. Mais il s'en détache tout autant. Sa facture est plus profane, au sens propre du terme (c’est-à-dire sur le parvis du Temple), ce qui l’oppose à la tragédie grecque. Il ne veut pas être une liturgie, même s’il tend à y introduire (ainsi spécialement des autos sacramentales d’un Calderon). Il n’est pas le lieu même du sacrifice, mais un symbole qui y renvoie. C’est là l’héritage de Jérusalem : un refus de l’idolâtrie, une distinction radicale de l’art et de la foi (ce qui ne veut pas dire une séparation). D’où sa tension interne de théâtre qui veut aller contre la fascination des spectacles. Aussi, quand Bossuet condamne la comédie, la raison est davantage avec lui qu'avec ceux qui la défendent comme une activité bénigne. Car il y va d'une chose grave, et le théâtre chrétien n'est jamais si bon que lorsqu'il porte avec lui sur la scène, sinon sa pure et simple condamnation, du moins sa sévère critique : une lutte contre son propre pouvoir d'hypnose et de divertissement.
Pour ce qui est du « théâtre chrétien » (mieux vaudrait parler du théâtre en chrétienté), la chose est plus malaisée à définir. Surtout en France, où la bataille pour ou contre les comédies fit rage à l’heure de l’apogée du théâtre classique, de sorte qu’on put écrire qu'un tel théâtre en lui-même semblait antichrétien. Ce théâtre hérite des Grecs, notamment d’Euripide, et des fameuses règles de la Poétique d’Aristote. Mais il s'en détache tout autant. Sa facture est plus profane, au sens propre du terme (c’est-à-dire sur le parvis du Temple), ce qui l’oppose à la tragédie grecque. Il ne veut pas être une liturgie, même s’il tend à y introduire (ainsi spécialement des autos sacramentales d’un Calderon). Il n’est pas le lieu même du sacrifice, mais un symbole qui y renvoie. C’est là l’héritage de Jérusalem : un refus de l’idolâtrie, une distinction radicale de l’art et de la foi (ce qui ne veut pas dire une séparation). D’où sa tension interne de théâtre qui veut aller contre la fascination des spectacles. Aussi, quand Bossuet condamne la comédie, la raison est davantage avec lui qu'avec ceux qui la défendent comme une activité bénigne. Car il y va d'une chose grave, et le théâtre chrétien n'est jamais si bon que lorsqu'il porte avec lui sur la scène, sinon sa pure et simple condamnation, du moins sa sévère critique : une lutte contre son propre pouvoir d'hypnose et de divertissement.

Fabrice Hadjadj
Je ressens profondément la justesse de votre réponse même si vous répondez "à côté". Au sujet de Pourim, c'est une fête rituelle rabbinique qui ne peut-être considérée comme "théâtre", sinon, à la rigueur, comme "pré-théâtre". Que la Bible soit "dramatisable" n'en fait pas pour autant une oeuvre théâtrale. À ce compte là tout est dramatisable, le bottin ou la recette du cassoulet. Ma question, trop abrupte, voulait évoquer d’emblée les racines religieuses du théâtre. Selon moi, le prophétisme hébreu procède au dépassement immédiat de la mimésis et nous projette dans un autre ordre de la réalité. Avec le Dieu d’Israël, la « clôture du théâtre de la représentation » est placée au commencement, en avance sur le temps lui-même : avant la naissance du théâtre, le système de la représentation spectaculaire occidentale est forclos. Cependant, comme vous le soulignez, la « matière » dramaturgique juive orientera toute l’histoire du théâtre. Et puis : Auschwitz. La Shoah opère un renversement radical de la perspective, la tragédie renaît juive : « Quel Dieu a pu laisser faire cela ? » Y a-t-il une autre question pour le théâtre aujourd’hui ?
Je ne peux répondre au nom de tout le théâtre aujourd’hui. Novarina dirait que la question est plutôt : « Quel Dieu possède ma langue ? » Pour ce qui me concerne, cette question que vous formulez : « Quel Dieu a pu laisser faire cela ? » se trouve au coeur de Massacre des Innocents. L’imminence dont je parlais tout à l’heure, cette tension du temps entre Massacre et Messie, atteint ici son paroxysme : le Messie est là, sur la paille, et au lieu de la gloire immédiate, c’est le déchaînement des ténèbres. La joie de Noël est suivie de l’horreur de l'extermination. La Consolation d’Israël non seulement n’empêche pas, mais s’avère aussi l’occasion d'une détresse plus grande : Rachel pleure ses enfants et ne veut pas qu’on la console. C'est pourquoi, parmi mes oeuvres dramatiques, cette pièce est « la plus juive », dans tous les sens de cette expression.
Cela nous amène à une autre question, non pour le théâtre mais pour les catholiques aujourd'hui. Nous prêchons la religion du Verbe fait chair, mais il semble qu’au quotidien, ni le verbe ni la chair ne soient pour nous mystère. Au contraire, pour nous comme pour les autres – et pire que les autres, car nous devrions savoir – les mots sont des moyens de communication, des véhicules du marketing, ce qui fait marcher le marché, le grande rotation des stocks, quand bien il s’agirait d’articles religieux. L'enjeu du théâtre est de faire taire ce bavardage. Avec son espace vide comme un ostensoir pour la présence réelle de l’animal parlant, il peut témoigner de ce mystère de la parole qui prend corps. Pas besoin de grand spectacle, pas besoin de sons et lumières, comme si l’épiphanie de la face et du souffle humains ne suffisaient pas, comme si l’incroyable araignée de la main n’étaient pas plus stupéfiante que tout monstre et machine. Mais voici : deux, trois sur le plateau – corps et âme, voix et vent – manifestent le drame de toute parole, l’intrigue de l’appel et de la réponse qui ne parviennent pas à s’ajuster, de l’adresse et du silence qui n’arrivent pas à s’entendre. Enfin, c’est déjà incroyable de parler : on remue quelques particules dans l’air, et ça fait de la pensée, de la promesse, du pardon, de la prière qui fend le ciel – mais aussi du mensonge qui ferme sur soi le couvercle. Un proverbe de Salomon le dit : Vie et mort sont au pouvoir de la langue.
Il y a dans Massacre des Innocents une cruauté saisissante, presqu’artaudienne, comme surgie de l’ellipse même du monstrueux. En même temps, votre parti pris de la simplicité scénographique, tel que vous l’affirmez dans un magistral post-scriptum, évoque Grotowsky ou, plutôt, Kotlarczyk : l’acteur est-il pour vous la donnée essentielle du théâtre ?
D’abord la cruauté. Du point de vue biographique, vous tapez juste : j'ai beaucoup lu Artaud, dans ma jeunesse, et aujourd'hui je lis toujours Michaux. On ne se défait pas facilement de ces doctores ex crudelitate. Du point de vue de l’oeuvre, Péguy avait déjà approché le mystère des Saints Innocents du côté de ses dedans de clémence, tel qu'il se pouvait voir en Dieu. Je ne pouvais pas faire mieux que lui. De ce mystère j’ai donc plutôt exploré les dehors de cruauté. Mais la question se pose de savoir si l’on peut faire un théâtre de la cruauté qui reste évangélique. N’y aurait-il pas là quelque compromission avec l’esprit du monde ? C'était le problème de Flannery O’Connor, et le malentendu avec ses lecteurs : « On s’imagine que je suis une nihiliste des montagnes, disait-elle, alors que je suis une thomiste des broussailles. » À vrai dire, un théâtre de l’espérance théologale est aussi un théâtre du plus grand désespoir à l’égard du monde. Un théâtre de la grâce est un théâtre du péché originel. Ergo, un théâtre de la cruauté n’est jamais si cruel que lorsqu’il repose sur la certitude de la clémence divine (et l’incertitude de notre accueil de celle-ci). Comme quoi le christianisme n’abolit pas la tragédie. Racine en savait quelque chose.
Pour ce qui concerne l’acteur, oui, il est la donnée essentielle. Il existe d’autres formes dramatiques : la poésie épique, le roman, le cinéma. Aucune d’elles ne suppose l’acteur. Surtout le cinéma. Contrairement à ce qu’on s’imagine, au cinéma, il n’y a pas d’acteurs (c’est d’ailleurs pour cela que l’image de la vedette se monnaye si facilement et vient nourrir le star-system). La salle n’est remplie que de spectateurs : devant eux, des images, derrière eux, le projectionniste. La pellicule se déroule impassible, sans aucun rapport vivant avec le public, sans personne qui prenne acte, dans l'œuvre, de l’ici et maintenant. Au théâtre, à l’inverse, c’est chaque soir une pièce différente : les réactions de la salle interagissent avec le jeu sur la scène. Aussi je reprendrais volontiers l’idée de Grotowsky selon laquelle on ne joue pas pour les spectateurs (ce qui est une supercherie et une prostitution), mais avec eux.
Je m'éloignerais de lui, néanmoins, dans la mesure où son théâtre est très mobile et privilégie les actions physiques violentes, la sueur, la bave, le cri, jusqu'à la transe collective. Mieux vaut, sous ce rapport, la distanciation d’un Brecht. Une certaine immobilité, sur le plateau vide, déploie plus de tension et d’énergie que la bougeotte et les gesticulations : elle peut affirmer la merveille déjà de la pure présence, montrer la profondeur des gestes quotidiens, dégager la fantastique puissance du visage, regard et bouche. Les mouvements démesurés ou les gestes en arabesque, il faut en laisser le soin à la danse. Ensuite, dans le jeu théâtral, je crois que c’est la parole qui prime, et s’il doit y avoir étreinte avec le public, selon le voeu de Grotowsky, c’est une étreinte de parole. Non pas une parole coincée dans la gorge, mais jaillissant d’en-dessous, du ventre, du corps tout entier porte-voix. Enfin, le théâtre ne donne pas le salut. Au mieux, il indique, ailleurs, où le salut se trouve. Ce fut la grande tentation d'Artaud, de Grotowsky ou, de nos jours, de Claude Régy, de faire de la représentation une grand’messe. Mais on n’est que des saltimbanques, pas des saints. Il ne faut pas prendre notre cabotinage trop au sérieux.
Je ne peux répondre au nom de tout le théâtre aujourd’hui. Novarina dirait que la question est plutôt : « Quel Dieu possède ma langue ? » Pour ce qui me concerne, cette question que vous formulez : « Quel Dieu a pu laisser faire cela ? » se trouve au coeur de Massacre des Innocents. L’imminence dont je parlais tout à l’heure, cette tension du temps entre Massacre et Messie, atteint ici son paroxysme : le Messie est là, sur la paille, et au lieu de la gloire immédiate, c’est le déchaînement des ténèbres. La joie de Noël est suivie de l’horreur de l'extermination. La Consolation d’Israël non seulement n’empêche pas, mais s’avère aussi l’occasion d'une détresse plus grande : Rachel pleure ses enfants et ne veut pas qu’on la console. C'est pourquoi, parmi mes oeuvres dramatiques, cette pièce est « la plus juive », dans tous les sens de cette expression.
Cela nous amène à une autre question, non pour le théâtre mais pour les catholiques aujourd'hui. Nous prêchons la religion du Verbe fait chair, mais il semble qu’au quotidien, ni le verbe ni la chair ne soient pour nous mystère. Au contraire, pour nous comme pour les autres – et pire que les autres, car nous devrions savoir – les mots sont des moyens de communication, des véhicules du marketing, ce qui fait marcher le marché, le grande rotation des stocks, quand bien il s’agirait d’articles religieux. L'enjeu du théâtre est de faire taire ce bavardage. Avec son espace vide comme un ostensoir pour la présence réelle de l’animal parlant, il peut témoigner de ce mystère de la parole qui prend corps. Pas besoin de grand spectacle, pas besoin de sons et lumières, comme si l’épiphanie de la face et du souffle humains ne suffisaient pas, comme si l’incroyable araignée de la main n’étaient pas plus stupéfiante que tout monstre et machine. Mais voici : deux, trois sur le plateau – corps et âme, voix et vent – manifestent le drame de toute parole, l’intrigue de l’appel et de la réponse qui ne parviennent pas à s’ajuster, de l’adresse et du silence qui n’arrivent pas à s’entendre. Enfin, c’est déjà incroyable de parler : on remue quelques particules dans l’air, et ça fait de la pensée, de la promesse, du pardon, de la prière qui fend le ciel – mais aussi du mensonge qui ferme sur soi le couvercle. Un proverbe de Salomon le dit : Vie et mort sont au pouvoir de la langue.
Il y a dans Massacre des Innocents une cruauté saisissante, presqu’artaudienne, comme surgie de l’ellipse même du monstrueux. En même temps, votre parti pris de la simplicité scénographique, tel que vous l’affirmez dans un magistral post-scriptum, évoque Grotowsky ou, plutôt, Kotlarczyk : l’acteur est-il pour vous la donnée essentielle du théâtre ?
D’abord la cruauté. Du point de vue biographique, vous tapez juste : j'ai beaucoup lu Artaud, dans ma jeunesse, et aujourd'hui je lis toujours Michaux. On ne se défait pas facilement de ces doctores ex crudelitate. Du point de vue de l’oeuvre, Péguy avait déjà approché le mystère des Saints Innocents du côté de ses dedans de clémence, tel qu'il se pouvait voir en Dieu. Je ne pouvais pas faire mieux que lui. De ce mystère j’ai donc plutôt exploré les dehors de cruauté. Mais la question se pose de savoir si l’on peut faire un théâtre de la cruauté qui reste évangélique. N’y aurait-il pas là quelque compromission avec l’esprit du monde ? C'était le problème de Flannery O’Connor, et le malentendu avec ses lecteurs : « On s’imagine que je suis une nihiliste des montagnes, disait-elle, alors que je suis une thomiste des broussailles. » À vrai dire, un théâtre de l’espérance théologale est aussi un théâtre du plus grand désespoir à l’égard du monde. Un théâtre de la grâce est un théâtre du péché originel. Ergo, un théâtre de la cruauté n’est jamais si cruel que lorsqu’il repose sur la certitude de la clémence divine (et l’incertitude de notre accueil de celle-ci). Comme quoi le christianisme n’abolit pas la tragédie. Racine en savait quelque chose.
Pour ce qui concerne l’acteur, oui, il est la donnée essentielle. Il existe d’autres formes dramatiques : la poésie épique, le roman, le cinéma. Aucune d’elles ne suppose l’acteur. Surtout le cinéma. Contrairement à ce qu’on s’imagine, au cinéma, il n’y a pas d’acteurs (c’est d’ailleurs pour cela que l’image de la vedette se monnaye si facilement et vient nourrir le star-system). La salle n’est remplie que de spectateurs : devant eux, des images, derrière eux, le projectionniste. La pellicule se déroule impassible, sans aucun rapport vivant avec le public, sans personne qui prenne acte, dans l'œuvre, de l’ici et maintenant. Au théâtre, à l’inverse, c’est chaque soir une pièce différente : les réactions de la salle interagissent avec le jeu sur la scène. Aussi je reprendrais volontiers l’idée de Grotowsky selon laquelle on ne joue pas pour les spectateurs (ce qui est une supercherie et une prostitution), mais avec eux.
Je m'éloignerais de lui, néanmoins, dans la mesure où son théâtre est très mobile et privilégie les actions physiques violentes, la sueur, la bave, le cri, jusqu'à la transe collective. Mieux vaut, sous ce rapport, la distanciation d’un Brecht. Une certaine immobilité, sur le plateau vide, déploie plus de tension et d’énergie que la bougeotte et les gesticulations : elle peut affirmer la merveille déjà de la pure présence, montrer la profondeur des gestes quotidiens, dégager la fantastique puissance du visage, regard et bouche. Les mouvements démesurés ou les gestes en arabesque, il faut en laisser le soin à la danse. Ensuite, dans le jeu théâtral, je crois que c’est la parole qui prime, et s’il doit y avoir étreinte avec le public, selon le voeu de Grotowsky, c’est une étreinte de parole. Non pas une parole coincée dans la gorge, mais jaillissant d’en-dessous, du ventre, du corps tout entier porte-voix. Enfin, le théâtre ne donne pas le salut. Au mieux, il indique, ailleurs, où le salut se trouve. Ce fut la grande tentation d'Artaud, de Grotowsky ou, de nos jours, de Claude Régy, de faire de la représentation une grand’messe. Mais on n’est que des saltimbanques, pas des saints. Il ne faut pas prendre notre cabotinage trop au sérieux.
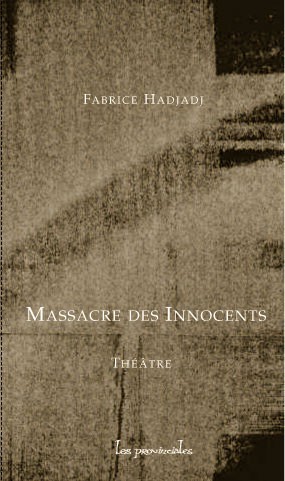
Pourrait-on dire que ce refus de l’hyperbole, du spectaculaire, ouvre l’espace d’une nouvelle dramaturgie classique, un théâtre de la litote – on ne meurt pas sur scène dans la tragédie – où l’humour montre la monstruosité sans la « représenter » ? La cruauté du Massacre des Innocents, ne serait-ce pas alors ce « rire » qui nous extrait de l’euphémisme de la représentation ?
Les gens rient au Massacre, ils pleurent aussi, parfois pour la même chose. Que le rire ait rapport au théâtre de la cruauté, cela ne fait pas de doute, car le rire est moins lié à la joie qu’à la décharge nerveuse. Mais il n’est pas nécessairement lié à la litote. Dans les films macabres, mais déjà chez Ovide, avec la bataille des Centaures et des Lapithes, le « gore » pousse l’horreur jusqu’au grotesque et finalement le met à distance par le rire.
Pour tout dire, je n’ai pas de méthode. J’écris les scènes comme il m’est donné de les voir. La théorie ne vient qu’après-coup. Cependant, j’ai ma petite idée sur le problème de la représentation du mal. Essayer de nous le faire voir en direct, comme si on y était, conduit de fait à une minimisation : à moins d’égorger un enfant dans la salle (et encore !), il s’agit toujours d’épouvantail et ketchup, et puis du public qui est assis sur des fauteuils de velours. En revanche, si vous mettez sur scène quelqu’un qui est assis comme n’importe quel spectateur, et qui commence à parler, à remonter le fil du temps jusqu’au moment passé de l’horreur, alors là, le spectateur suit, entre, plonge avec dans l’abîme. C’est la grande leçon de Claude Lanzmann, mon maître autant que Claudel (mais on n’aime pas trop le savoir). En partant de témoignages ici et maintenant, il nous entraîne beaucoup plus loin que n’importe quel amoncellement de cadavres d’archives : non seulement il part de notre situation présente, mais aussi il fait sortir la chose de nous-même, puisque notre imagination doit se faire active. C’est la richesse du théâtre par rapport au cinéma, cette pauvreté qui oblige le spectateur, à partir de la parole, et avec son imaginaire, de participer activement à la représentation. Son euphémisme est la voie d’un réalisme puissant, incomparablement plus puissant que si on prétendait montrer la réalité sur scène ou sur écran, alors qu’on est dans son living-room ou dans une salle de spectacle.
Votre dramaturgie prend en compte le lieu d’où retentit la parole théâtrale. Une de vos créations, La Salle capitulaire, donne à voir l’espace de la rencontre entre votre texte et les tableaux de Gérard Breuil exposés dans la salle capitulaire de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus. L’acteur, la parole et le lieu : votre théâtre se joue-t-il en ces trois mots ?
Gérard Breuil s’est aussi chargé de la scénographie du Massacre : à jardin, comme un mur des Lamentations, et vers cour, une tombée d’âmes diaphanes, entre pollen et feuilles mortes, oiseaux et nénuphars. Son travail peut faire penser à Soulages ou à Barnett Newman, mais il a son originalité propre, et surtout cette simplicité cistercienne qui permet d’éviter le décoratif et le trompe-l’œil, et plutôt que d’encombrer, d’ouvrir l’espace. Il n’occupe pas la scène, il ménage un lieu où telle parole peut prendre chair, tel verbe devenir visible.
La question du lieu est donc fondamentale. Il faudrait à chaque fois repenser la mise en scène en fonction d’un lieu précis. S’il y a une conduite qui passe quelque part, si une soufflerie déborde sur le plateau, ne pas les cacher, - jouer avec. La cas du « spectacle pour voix-off » donné dans la salle capitulaire de l’abbaye de Tournus est particulier. En général, j’aime mieux des salles quelconques : polyvalente, communale, de réunion ou des fêtes (si l’on y peut voir et entendre quelque chose). Quand on me propose de jouer dans une chapelle, je refuse, et pas seulement pour des considérations acoustiques. Je préfère sacraliser un lieu profane que de profaner un lieu sacré. Une rue, un hangar, une piscine, un bordel, un terrain vague : faire sentir qu’il y a là encore un mystère, comme en ces endroits sans apparat où soudain paraît le buisson ardent, où peu à peu Jacob entre dans son songe : l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas !
Il semble que votre œuvre théâtrale soit inséparable d’une communauté de vie et de l’éthique quelle implique. Accepteriez-vous de nous parler, à la fin de cet entretien, du Caillou blanc et de son projet artistique ?
La réalité administrative de la Compagnie du Caillou blanc est évanescente : le bureau ne se réunit guère, les comptes sont en friche, nous employons généralement la licence-spectacle d’autres compagnies. Depuis le début, nous avons pour producteur ou associé Olivier Véron, des Provinciales, si profondément attaché au mystère d’Israël, depuis ses racines célestes jusqu’à ses plus politiques surgeons. Mais derrière il y a toujours une manière de pratiquer le théâtre. D’abord, c’est un renvoi à l’Apocalypse qui fait analogiquement la charte de notre travail : Au vainqueur je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc : sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. Que le spectacle puisse rejoindre l’intime, que sa parole publique puisse renvoyer au silence du cœur, en sorte que chacun entende quelque chose comme nul autre et se renouvelle dans son unicité, voilà notre horizon vraiment populaire.
Pour Massacre des Innocents, j’ai tenu à travailler avec des mères de famille, et d’abord avec ma femme comédienne, de qui je tiens ma vocation pour le théâtre. L’enjeu était de se prouver que les deux n’étaient pas incompatibles, que la scène n’était pas contre la vie. Nous avons dû aménager des gardes, des pauses-allaitements, ne pas craindre de répéter parmi les cris du nourrisson. Il a fallu remanier le spectacle avec une comédienne de moins parce que sa grossesse était difficile et que le médecin, au final, lui suggéra de ne pas travailler. Il a même fallu avoir ma belle-mère à demeure durant plus de deux mois : si ça n’est pas de l’éthique ! Quoi qu’il en soit, les exigences du théâtre sont telles que souvent elles paraissent interdire la maternité. La massacre s’accomplit alors réellement en coulisse : on refuse une naissance, on délaisse ses enfants, on néglige sa maisonnée pour les feux de la rampe. Combien de petits cercueils fabriqués avec les planches ? Il fallait donc, sur l’espace public, réserver l’espace privé, et reconnaître que les planches brûlent moins que le simple foyer. Là encore, c’est le caillou contre le monument, l’embryon contre le monstre sacré.
Les gens rient au Massacre, ils pleurent aussi, parfois pour la même chose. Que le rire ait rapport au théâtre de la cruauté, cela ne fait pas de doute, car le rire est moins lié à la joie qu’à la décharge nerveuse. Mais il n’est pas nécessairement lié à la litote. Dans les films macabres, mais déjà chez Ovide, avec la bataille des Centaures et des Lapithes, le « gore » pousse l’horreur jusqu’au grotesque et finalement le met à distance par le rire.
Pour tout dire, je n’ai pas de méthode. J’écris les scènes comme il m’est donné de les voir. La théorie ne vient qu’après-coup. Cependant, j’ai ma petite idée sur le problème de la représentation du mal. Essayer de nous le faire voir en direct, comme si on y était, conduit de fait à une minimisation : à moins d’égorger un enfant dans la salle (et encore !), il s’agit toujours d’épouvantail et ketchup, et puis du public qui est assis sur des fauteuils de velours. En revanche, si vous mettez sur scène quelqu’un qui est assis comme n’importe quel spectateur, et qui commence à parler, à remonter le fil du temps jusqu’au moment passé de l’horreur, alors là, le spectateur suit, entre, plonge avec dans l’abîme. C’est la grande leçon de Claude Lanzmann, mon maître autant que Claudel (mais on n’aime pas trop le savoir). En partant de témoignages ici et maintenant, il nous entraîne beaucoup plus loin que n’importe quel amoncellement de cadavres d’archives : non seulement il part de notre situation présente, mais aussi il fait sortir la chose de nous-même, puisque notre imagination doit se faire active. C’est la richesse du théâtre par rapport au cinéma, cette pauvreté qui oblige le spectateur, à partir de la parole, et avec son imaginaire, de participer activement à la représentation. Son euphémisme est la voie d’un réalisme puissant, incomparablement plus puissant que si on prétendait montrer la réalité sur scène ou sur écran, alors qu’on est dans son living-room ou dans une salle de spectacle.
Votre dramaturgie prend en compte le lieu d’où retentit la parole théâtrale. Une de vos créations, La Salle capitulaire, donne à voir l’espace de la rencontre entre votre texte et les tableaux de Gérard Breuil exposés dans la salle capitulaire de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus. L’acteur, la parole et le lieu : votre théâtre se joue-t-il en ces trois mots ?
Gérard Breuil s’est aussi chargé de la scénographie du Massacre : à jardin, comme un mur des Lamentations, et vers cour, une tombée d’âmes diaphanes, entre pollen et feuilles mortes, oiseaux et nénuphars. Son travail peut faire penser à Soulages ou à Barnett Newman, mais il a son originalité propre, et surtout cette simplicité cistercienne qui permet d’éviter le décoratif et le trompe-l’œil, et plutôt que d’encombrer, d’ouvrir l’espace. Il n’occupe pas la scène, il ménage un lieu où telle parole peut prendre chair, tel verbe devenir visible.
La question du lieu est donc fondamentale. Il faudrait à chaque fois repenser la mise en scène en fonction d’un lieu précis. S’il y a une conduite qui passe quelque part, si une soufflerie déborde sur le plateau, ne pas les cacher, - jouer avec. La cas du « spectacle pour voix-off » donné dans la salle capitulaire de l’abbaye de Tournus est particulier. En général, j’aime mieux des salles quelconques : polyvalente, communale, de réunion ou des fêtes (si l’on y peut voir et entendre quelque chose). Quand on me propose de jouer dans une chapelle, je refuse, et pas seulement pour des considérations acoustiques. Je préfère sacraliser un lieu profane que de profaner un lieu sacré. Une rue, un hangar, une piscine, un bordel, un terrain vague : faire sentir qu’il y a là encore un mystère, comme en ces endroits sans apparat où soudain paraît le buisson ardent, où peu à peu Jacob entre dans son songe : l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas !
Il semble que votre œuvre théâtrale soit inséparable d’une communauté de vie et de l’éthique quelle implique. Accepteriez-vous de nous parler, à la fin de cet entretien, du Caillou blanc et de son projet artistique ?
La réalité administrative de la Compagnie du Caillou blanc est évanescente : le bureau ne se réunit guère, les comptes sont en friche, nous employons généralement la licence-spectacle d’autres compagnies. Depuis le début, nous avons pour producteur ou associé Olivier Véron, des Provinciales, si profondément attaché au mystère d’Israël, depuis ses racines célestes jusqu’à ses plus politiques surgeons. Mais derrière il y a toujours une manière de pratiquer le théâtre. D’abord, c’est un renvoi à l’Apocalypse qui fait analogiquement la charte de notre travail : Au vainqueur je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc : sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. Que le spectacle puisse rejoindre l’intime, que sa parole publique puisse renvoyer au silence du cœur, en sorte que chacun entende quelque chose comme nul autre et se renouvelle dans son unicité, voilà notre horizon vraiment populaire.
Pour Massacre des Innocents, j’ai tenu à travailler avec des mères de famille, et d’abord avec ma femme comédienne, de qui je tiens ma vocation pour le théâtre. L’enjeu était de se prouver que les deux n’étaient pas incompatibles, que la scène n’était pas contre la vie. Nous avons dû aménager des gardes, des pauses-allaitements, ne pas craindre de répéter parmi les cris du nourrisson. Il a fallu remanier le spectacle avec une comédienne de moins parce que sa grossesse était difficile et que le médecin, au final, lui suggéra de ne pas travailler. Il a même fallu avoir ma belle-mère à demeure durant plus de deux mois : si ça n’est pas de l’éthique ! Quoi qu’il en soit, les exigences du théâtre sont telles que souvent elles paraissent interdire la maternité. La massacre s’accomplit alors réellement en coulisse : on refuse une naissance, on délaisse ses enfants, on néglige sa maisonnée pour les feux de la rampe. Combien de petits cercueils fabriqués avec les planches ? Il fallait donc, sur l’espace public, réserver l’espace privé, et reconnaître que les planches brûlent moins que le simple foyer. Là encore, c’est le caillou contre le monument, l’embryon contre le monstre sacré.
Propos recueillis par Alain Santacreu. Entretien paru dans Contrelittérature n° 19, été 2007.

 Imprimer
Imprimer