De quoi Badiou est-il le nom ?
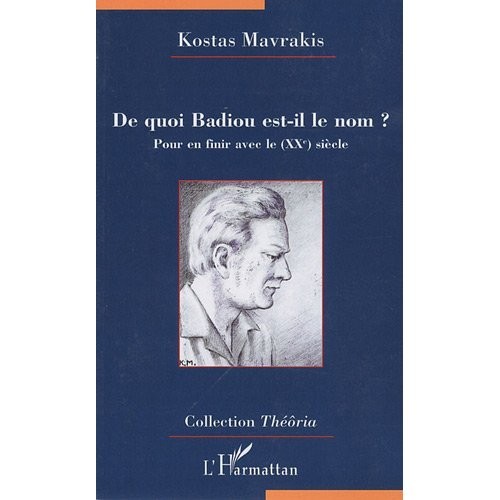
Odieux Badiou !
par Alain Santacreu
Que Badiou soit un des noms du « très bas », on s’en persuadera en lisant l'essai ravageur de Kostas Mavrakis. Ce petit livre très dense est un acte de foi, un autodafé subjectif, une critique « intérieure » de la praxis de l’autocritique maoïste. En effet, dans les années 70, Badiou collabora à la revue Théorie et politique fondée par Mavrakis, alors proche zélateur de la Gauche prolétarienne et, vingt ans plus tard, il présida le jury de la thèse universitaire soutenue par l’auteur. Cette histoire est donc celle d’une relation de maître à disciple, d’une amitié intellectuelle qui, en se terminant mal, nous vaut aujourd’hui cet ardent pamphlet philosophique.
Le titre nous oriente vers la finalité de l’ouvrage. Dans De quoi Sarkozy est-il le nom ? (2007), best-seller qui a contribué à sa notoriété médiatique, Badiou, sous prétexte de critiquer notre fraîchement émoulu président, exposait sa vision politique ; le détournement du titre de son ouvrage par Mavrakis est mimétique : l’auteur, tout en proposant une critique irradiante de celui qu’il nomme – avec quelque ironie, espérons-le ! – « le plus grand philosophe vivant », en profite pour avancer ses propres convictions politique, religieuse et esthétique. Ainsi, Badiou devient pour Mavrakis ce que les hindous appellent un upaguru, c’est-à-dire une « cause occasionnelle » susceptible de déclencher une prise de conscience, une ouverture spirituelle. Comme l’affirme le proverbe, « le diable porte pierre » : un étron peut, en certaines circonstances, jouer le rôle d’upaguru.
La rupture de Mavrakis avec Badiou a lieu en 2005, lorsque paraît Le Siècle, une apologie éhontée de l’art contemporain. Badiou y approuve les avant-gardes artistiques qui, tout au long du vingtième siècle, ont préféré « sacrifier l’art que céder sur le réel » [1]. La mort de l’art est donc, selon lui, l’acte sacrificiel qui permet la réalisation du réel, c’est-à-dire « la mort de Dieu ». Si Badiou n’avait pas joint sa voix aux ennemis de l’art, sans doute ce petit livre n’aurait-il pas vu le jour. Docteur en philosophie et en arts plastiques, peintre, Kostas Mavrakis a publié, en 2006, Pour l’Art. Éclipse et renouveau, ouvrage auquel il renvoie très souvent tout au long de son pamphlet.
Pour Badiou, les avant-gardes, en destituant l’œuvre de l’artiste, avaient pour finalité un art matérialiste et athée. Mavrakis ne semble pas remettre en question cette interprétation. Contrairement à d’autres analyses contemptrices de l’art contemporain, comme celles de Christine Sourgins ou d’Aude de Kerros, il ne relève pas la rupture essentielle qui se joue, au détour des années 60, avec le schisme duchampien, ce qui l’amène à voir une continuité nihiliste entre le modernisme et ce qu’il appelle le non-art. Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement le domaine russe, il ne distingue pas entre modernisme et modernité, deux notions fondamentales dans l’évolution de l’art moderne, développées par Gérard Conio dans L’Art contre les masses où cet auteur démontre la contradiction entre l’organicité moderniste et spirituelle du cubo-futurisme et la mécanicité de la modernité matérialiste et constructiviste. Un parallélisme serait aussi à faire , selon nous, entre l’échec de cette avant-garde radicale et l’écrasement du socialisme non-étatique des conseils ouvriers : « Les artistes et les poètes d’avant-garde avaient une tout autre visée que le bolchévisme. La plupart d’entre eux se sentaient plus proches du mouvement anarchiste. Tatline avait conçu et fabriqué un poêle pour les frères Gordine, les dirigeants de ce mouvement. Malévitch écrivait dans la revue Anarkhia. Mais quand les anarchistes furent éliminés, comme tous les partis et courant de gauche, les jeux étaient faits. » [2] L’idée archétypale du communisme est chrétienne et c’est bien pour cela qu’il s’agissait d’étouffer l’avant-garde radicale avant, qu’au delà de l’ombre portée de l’anarchisme, elle ne prenne conscience de l’esprit « traditionnel » de l’idée libertaire.
La pensée badiouesque n’est que la soufflure du mot-baudruche « communisme » que Mavrakis, lui, par sa conversion, a crevé à la fine pointe de son âme. L’ancien disciple n’hésite pas à plonger son calame dans l’eau vaseuse et croupissante où le maître s’est baigné. Il le fait apparemment sans dégoût, c’est charitable et salubre : pourquoi faudrait-il masquer, déguiser, farder, altérer, incliner la vérité pour ne pas mécontenter, blesser, vexer tous ceux qui sont malades et qui nous contaminent ? Un chrétien ne peut se faire le complice de ceux qui maintiennent « la Vérité captive » – pour reprendre le titre de l’ouvrage remarquable de Maxence Caron. Mavrakis, désigne Badiou comme son « adversaire », c’est peu dire car, bien loin d’être une respectable joute philosophique, il s’agit là d’un véritable combat pour l’âme de l’homme, du destin de l’art, le plus fondamental des enjeux civilisationnels, selon Mavrakis.
Badiou, toute honte bue, a osé émettre l’hypothèse d’une invariance idéelle, presque platonicienne, du communisme. L’ancien maoïste s’est permis de revisiter l’histoire et de se réapproprier les luttes authentiques des opprimés que le totalitarisme bolchévique – qu’il soit russe, chinois ou de Pétaouchnok – a toujours écrasées. De quel côté, odieux Badiou, étaient les invariants communistes tout au long de l’histoire : en 1921, à Cronstad, en 1937, à Barcelone, en 1956, à Budapest et, même, en 1968, à Paris ? Il est abject de présenter comme une fatalité de l’histoire le fait que la révolte spontanée des masses soit systématiquement appropriée et détournée par les forces historiques qui deviendront ultérieurement dominantes. Ce fut le cas en 1968, quand les étudiants, les intellectuels et les ouvriers, tous lobotomisés par le marxisme-léninisme, préparaient la voie de la nouvelle élite techno-libérale. Être maoïste en 1968, ce n’était pas « tenir un point de réel » mais participer à la mystification de l'histoire. Alors que Badiou est resté immuablement maoïste, Mavrakis, en se convertissant au christianisme, s’est ouvert à la Présence réelle.
Dans son pamphlet, Mavrakis démontre de façon admirable combien les positions badiouesques rejoignent celles de ce libéralisme qu’il prétend combattre : « Le monde du grand capital transnational unifié par le marché et la circulation des signes monétaires engendre une idéologie qui exalte l’uniformisation dont une variante s’exprime dans les écrits politiques de Badiou ». (p. 19) La peur de Badiou, c’est de perdre son nom ; et cette peur, la crainte de décevoir ses affidés, le précipite dans ce « pétainisme analogique » qu’il prétend dénoncer : il vend son âme comme un ready-made, à l’unisson des Pinault et Arnault, sa philosophie s’assimile au « non-art ».
En effet, l’art des avant-gardes du XXe siècle est une désorientation organisée par le capital à travers les différentes formes du capitalisme, d’État ou libéral. Si, pour Badiou l’événement est la crise qui appelle l’avènement d’une vérité nouvelle, on concevra qu’il n’y ait, pour un chrétien, qu’un seul événement continué : la Révélation. On regrettera par conséquent que Mavrakis, lui-même chrétien, se soit placé, dans sa critique du non-art, sur le terrain « philosophique » – de cette philosophie qui, pour Badiou, naît de l’invention de la mathématique : philosophie de la quantité et de la modernité – plutôt que de développer une critique théologique de l’art contemporain. Cependant, l’auteur emploie dans un passage une expression particulière qui pourrait être la clé véritablement chrétienne de son pamphlet : « Des gens intelligents, dont certains sont même sensibles à la peinture, prennent fait et cause pour ce prétendu "art contemporain". Comment s’expliquer qu’ils confondent ainsi l’art et le non-art, le beau et le nul, ce qui revient en fait à intervertir le bien et le mal, le vrai et le faux ? j’ai toujours été frappé par ce mystère d’iniquité » (p. 64).
Un chrétien ne peut employer inconsidérément l’expression « mystère d’iniquité » ; c’est une périphrase qui n’intervient qu’une seule fois dans les Écritures, dans une Épître de saint Paul, pour désigner l’Antichrist : « Et maintenant, vous savez ce qui le retient (to katékhon) pour qu’il ne soit révélé qu’en son temps. Car le mystère de l’iniquité est déjà à l’œuvre ; il suffit que soit écarté celui qui le retient (ho katékhon) » [3]. Saint Paul nous dit que « quelque chose » empêche la manifestation de l’ennemi de la vérité. Il est généralement admis que cette puissance qui fait obstacle (to katékhon) est l’Empire romain. Évidemment, si l’on estime que l’Empire romain s’est éteint depuis longtemps, il faut en conclure que, depuis cette disparition, l’Antichrist est parmi nous. Mais on peut aussi considérer que l’Empire romain a subsisté jusqu’à nos jours sous la forme des nations européennes de l’Empire chrétien. Le Traité de Rome, signé en 1957, en instituant la Communauté économique européenne a peut-être une signification eschatologique que dévoilerait son propre nom. Quant à la date, elle indique le proche avènement du schisme duchampien, cette inversion de l’art contemporain qu’il nous faut interpréter comme le négatif révélateur de l’Abomination de la désolation.
On remarquera que dans son livre Mavrakis parle avec insistance de la haine de Badiou pour la « civilisation » européenne. D’une certaine façon les nations chrétiennes se sont dissoutes dans l’Union européenne. Cette dissolution a produit le triomphe de Sarkozy et Badiou, deux noms qui désignent la même chose.
[1] Le Siècle, Éditions du Seuil, 2005, p. 185.
[2] Gérard Conio, Les Avant-Gardes : entre métaphysique et histoire, L'Âge d'Homme, 2003, p. 13.
[3] 2 Th 2, 6-7.

 Imprimer
Imprimer