CONTRELITTÉRATURE
« Ne recherche pas qui a dit cela, mais porte toute ton attention à ce qui est dit. » (Sénèque, Lettres à Lucilius, XII)

Ancienne Revue Contrelittérature (1999-2008)
Contr'art
- Art caché et décroissance
- Claudel, le théâtre à venir
- Corps sans organes ou vaudouisation de l'âme ?
- Création théologique et création artistique
- Kleist et le spectateur-marionnette
- L'Acteur, la Parole, Le Lieu
- l'Art de l'Espérance
- L'Atelier de la Rose
- L'hypothèse Grabar
- La troisième boisson de René Daumal
- Le Cœur émeraude de Roberto Mangú
- Le fantôme d'Edmond Jaloux
- Le théâtre de Michel Mourlet
- Lire et écrire avec son ange
- Marcel Duchamp : un éveillé au centre de la modernité
- Novalis/Novarina
- Parvulesco et le cinéma
Religion/Symbolisme
- Al-Khadir, la voie mariale des afrad
- Contre la thèse de Jérôme Rousse-Lacordaire
- En compagnonnique mais divergent accord
- Israël-Ismaël (1)
- Israël-Ismaël (2)
- Jean Reuchlin : christianisme et Cabale
- Jean Romanidès : l'acratie christique ou la guérison de la religion
- L'hostie féminine de Dieu
- La contrelittérature et la langue du sanctuaire (1)
- La contrelittérature et la langue du sanctuaire (2)
- La mort devant soi
- La passion d'Eugraph Kovalevsky
- La plus belle des ruses d'acédie
- La théologie curative de Jean Romanidès
- La Vérité si je mens !
- Une résurgence italienne de l'ésotérisme chrétien
Géopolitique transcendantale
- 11 septembre 2001 : la mort d'Ulysse
- Alain Daniélou, un forlignage spirituel
- Espagne : la mémoire garrottée (1)
- Espagne : la mémoire garrottée (2)
- Grasset d'Orcet : une relecture ésotérique de l'histoire
- Jean Parvulesco : le secret de la romance
- Ligatures
- Misère et splendeur de la traduction selon Ortega y Gasset
- Mort ou résurrection de Jacques Bonhomme ?
- Odieux Badiou !
- Un virus pharmakon ?
Acratie/Critique sociale
- Contrelittérature et autogestion
- Cow-boy du savoir
- Entraide et (r)évolution agapique
- Francis Cousin répond à Alain Santacreu
- L'acratie théologique de Jean Romanidès
- L'esprit traditionnel de l'idée libertaire
- Mort ou résurrection de Jacques Bonhomme ?
- Obéir en résistant
- Pour un dialogue sur la laïcité
- Principes d'an-archie pure et appliquée
- Progreso Marin : tant que notre mémoire durera
- Protestation devant les libertaires du présent et du futur sur les...
- Proudhon : des pistes pour le présent
- Remarques sur "L'Anarchisme chrétien"
- Sur un livre de Rémi Soulié
- Un terrorisme sémantique d'État
- Une théologie de la communication ?
- Virer Debord et Marx par dessus bord
Contrelittérature : quelques jalons
- Cette attention dont parle Simone Weil
- Enquête sur le roman
- Entretien avec "Rébellion"
- Gens de lettres et gens de l'être
- Joseph de Maistre "en réserve" de la contrelittérature
- L'exil contrelittéraire
- La "putréfiction" des Lumières
- La récapitulation de la littérature
- La talvera
- Le livre-hexagramme de Jean Parvulesco
- Le manifeste contrelittéraire
- Le nom du père et le nom du fils
- Le théâtre d'ombre de M. Jules Bois
- Lire et écrire avec son ange
- Nessence
- Oedipe et Perceval
- Parvulesco et moi
- Talvera et Usura
En castellano
In italiano
"Ne recherche pas qui a dit cela, mais porte ton attention sur ce qui est dit." (Sénèque)
PAYPAL
ÉDITIONS CONTRELITTÉRATURE
LE ROMAN RETROUVÉ
- "Distorsion historique" (Olivier Rachet)
- Ali Benziane sur le site Pileface/Sollers
- Chanson-annonce
- Compte-rendu de Jean-Paul Gavard-Perret
- Compte-rendu de Nicolas Floury
- Compte-rendu sur Webmag
- Festival Quartier du livre 2024
- Invitation Rencontre
- La postface (refusée) de Luc de Goustine
- La seule perspective romanesque qui vaille
- Philippe Thireau sur La Cause Littéraire
- Portrait de l'anartiste en anécrivain
- Recension d'Olivier Benyahya
- Recension de Vincent Roussel
- Rencontre autour du "roman retrouvé"
- Une recension du "rat noir"
TALVERA
- Vers un anarchisme transdisciplinaire
- Un arbre sur la talvera
- Sur le mur d'une maison dans un faubourg de Toulouse
- Stéphane Lupasco et l'écosophie
- Sous l'égide libertaire d'Étienne de La Boétie
- Profaner le Graal
- Patriotisme révolutionnaire et nationalisme intérieur
- Opération Duchamp (entretien avec Alain Boton)
- Making-of de "En quête d'une gnose anarchiste"
- Le renversement de l'axe Toulouse-New York chez Raymond Abellio
- Le lieu de l'art et l'espace du spectacle
- Le corps-anagramme d'Unica Zürn
- La pensée hérétique face au totalitarisme des idées
- L'éthique des Gilets Jaunes
- L'anarchisme trahi par les siens
- Jeu d'anarchie dans l'oeuvre de Mehdi Belhaj Kacem
- Épiméthée, la voie orphique de l'anarchie
- Entretien avec "la revue du Comptoir"
- Contrelittérature et alchimie
- Ce que disait Emmanuel Goldstein
- Artaud-Daumal : une rencontre fatidique pour le théâtre
- Approche du mal radical (vidéo)
- Approche du mal radical (transcription)
- Apocalypse sans royaume
- Anthropologie fondamentale pour une gnose anarchiste
- "Le Grand Orient : les Lumières sont éteintes"
- "Délire et vérité" de Nicolas Floury
LE SOLEIL DE GAZA
- a. Les eaux de Mériba (Alain Santacreu)
- b. Véronique la Lévite (Alain Santacreu)
- c. Les portes de l'enfer (Ali Benziane)
- d. La tsadaqah est morte (Alain Santacreu)
- e. Sous l'égide de Leibowitz (Gérard Haddad)
- f. Et Abel tua Caïn... (Ali Benziane)
- g. Seul, un pas en arrière... (Jean-François Gomez)
- h. Les femmes et les enfants d'abord ! (Mehdi B. Kacem)
- i. Une honte éternelle... (Ali Benziane)
- j. Gaza (Amel Zmerli)
- k. Le contre-sionisme est un humanisme (Alain Santacreu)
- l. Gott mit uns ! (Ali Benziane)
- m. Faire peuple et retrouver Sion (Alain Santacreu)
- n. Le contre-sionisme d'Isaac Asimov
- o. Le tiqqun de la paix (Gabriel Hagaï)
- p. Gaza en Hûrqalyâ (Alain Santacreu)
- q. Le fils d'homme est tombé à Gaza (Alain santacreu
- r. Un colonialisme de remplacement (Pierre Stambul)
- s. La machine mythologique. Théorie messianique de l'État-total...
- t. "Anthropologie du sionisme" (entretien avec Gérard Haddad)
- u. Le courage de la poésie (Susan Abulhawa)
- v. Le génocide incestueux (Alain Santacreu)
- w. L'homme qui voyait au-delà de l'horizon (Nicolas Floury)
- x. Le contresionisme qui vient
Ouvertures
- "Le totalitarisme en marche" de Vincent Pavan (par Nicolas Floury)
- Agamben-Péguy : une mise en dialogue pour une théologie politique
- Ali Benziane a lu le dernier roman de Jacob Cohen
- Basquin lit "H" de Sollers
- Basquin lit "Psychopathologie du totalitarisme" d'Ariane Bilheran
- De la désorientation des intellectuels (Guillaume Basquin)
- Entretien avec Georges Lapierre
- Jean-Marie Guyau (1854-1888) par Jordi Riba
- Le film-testament de Guy Debord (Julien Bielka)
- Présence de Yeshayahou Leibowitz (1903-1994)
- Qu'est-ce que le Système du pléonectique ? (Guillaume Basquin)
- Un texte d'Ivan Segré
Brèves
- "Anarchie souveraine" (par l'Observatoire Situationniste)
- "Colaricocovirus" de Mehdi Belhaj Kacem
- "Coup d'État" de Juan Branco
- "L'Histoire splendide" de Guillaume asquin
- "Le temps des peurs" de Michel Maffesoli
- "Mausolée des intellectuels" de Mehdi Belhaj Kacem (Julien Bielka)
- Approche du mal radical (transcription)
- Le jeu des collabobos
- Ligne de risque n°3 : "Aperçus sur l'Immonde"
- Sur la cinéaste Kit Zauhar (Nicolas Floury)
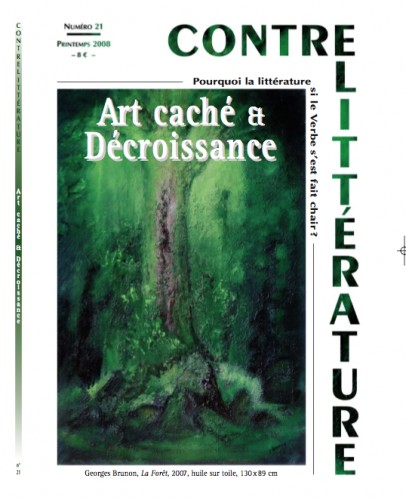
 Imprimer
Imprimer