Paul Claudel, le théâtre à venir (mardi, 03 novembre 2009)
LE THÉÂTRE DU SEPTIÈME JOUR

En 1896, quand Paul Claudel compose Le Repos du septième Jour, dix ans se sont écoulés depuis sa conversion au catholicisme, à dix-huit ans, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'étaient les vêpres de Noël 1886. Six mois avant, il avait lu Rimbaud, Les Illuminations. Il avait vu alors s'ouvrir une « fissure » dans ce qu'il a appelé son « bagne matérialiste ». Il a décrit ce moment décisif de sa vie : « J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable »[1].
La seule représentation dramaturgique que Paul Claudel ait proposée de cet instant unique se trouve dans la première mouture de La Ville (1893) ; mais la séquence en sera vite supprimée et jamais plus ce thème ne réapparaîtra (1901). En effet, la conversion ne peut appartenir au théâtre de la représentation. C'est pourquoi, Le Repos du septième Jour, en tant que dépassement claudélien des limites théâtrales, occupe une place si décisive dans son œuvre dramaturgique. Il lui aura fallu une décade pour s'extraire de la décadence du siècle. Dix ans pour obtenir la confirmation de cette conversion par l'écriture dramatique.
La pièce a été composée en Chine, entre Shangaï et Fou-Tchéou, où notre jeune diplomate est alors en poste. Elle paraît en 1901 dans L'Arbre, recueil qui réunit l'ensemble du premier théâtre claudélien ( Tête d'Or, La Ville, La Jeune Fille Violaine, L'Échange ). De toutes ces œuvres théâtrales, Le Repos du Septième jour est la moins connue et la moins jouée. Elle ne sera créée sur la scène française qu'en 1965, dans une mise en scène de Pierre Franck. Du vivant de Claudel, deux représentations seulement avaient eu lieu, hors de France : au théâtre Narodowy de Varsovie en 1928 et à Fulda, en Allemagne, lors des journées catholiques de 1954 ( à cette occasion il écrira un texte de présentation qui souligne la valeur religieuse et spirituelle de la pièce).
En Chine, il s'était très intéressé à l'effort missionnaire des Jésuites pour découvrir une forme de pré-christianisme dans l'antique religion chinoise[2] et l'intrigue de sa pièce est imprégnée des croyances de la Chine ancestrale. En 1895, notre jeune vice-consul arriva à Shangaï au mois d'avril, alors que débutait Qingming, la fête chinoise des Morts. Dans Connaissance de l'Est, écrit à la même époque, plusieurs poèmes en prose parleront des défunts et décriront les cérémonies qui leur sont consacrées[3]. Dans ce vieux paganisme chinois, fait de la peur des morts et de la crainte des maléfices, Claudel reconnaît la peur de l'homme moderne occidental et c'est dans cette ambiance qu'il conçoit le Repos du Septième Jour.
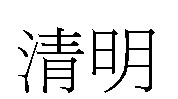 À l'occasion de Qingming, les esprits des morts remontent sur la terre. Pour se les concilier, on les accueille avec respect, on les vénère puis, une fois la fête finie, on les renvoie à leur repos éternel. Mais, dans Le Repos du Septième Jour, les morts ne s'en retournent pas...
À l'occasion de Qingming, les esprits des morts remontent sur la terre. Pour se les concilier, on les accueille avec respect, on les vénère puis, une fois la fête finie, on les renvoie à leur repos éternel. Mais, dans Le Repos du Septième Jour, les morts ne s'en retournent pas...
Dans le premier acte, l'Empereur de Chine apprend le malheur qui frappe son peuple menacé par l'invasion des morts. Armé de son bâton impérial, il décide alors de se sacrifier et de descendre dans les entrailles de la terre. Il va poser la question à laquelle les hommes ne peuvent répondre : pourquoi le Ciel a-t-il permis que les morts reviennent, pourquoi empiètent-ils sur le domaine des vivants, pourquoi ce trouble et quel désordre antérieur, quelle faute inouïe l'ont-ils permis ? Cette reprise de la question mallarméenne : « Qu'est-ce que cela veut dire ? »[4] donne au drame son orientation symboliste : le réel n'est que l'apparence et la signification d'un plus hault sens. Le retour des morts est un appel de la mort elle-même. La mort spirituelle de l'humanité , qui a chassé Dieu d'entre les hommes, a laissé un vide qui aspire les morts. Pour Claudel, les damnés sont des signes : puisqu'ils n'ont pas voulu témoigner de l'amour de Dieu, ils doivent témoigner de sa justice, ainsi l'équilibre est maintenu entre la miséricorde et la rigueur divines. Peut-être Claudel a-t-il déjà pressenti dans Eschyle, dont il vient tout juste de terminer la traduction de l'Agamemnon, la possibilité d'un baptême de l'âme païenne ?
 Tout le second acte de la pièce se déroule en Enfer, au royaume des morts. Après d'hallucinants dialogues, d'abord avec sa propre Mère, puis avec le Démon, l'Empereur rencontre l'Ange de l'Empire qui lui révèle l'œcuménisme de l'ordre universel et lui transmet le « remède » pour sauver le « Royaume des vivants ». Enfin, dans le troisième acte, l'Empereur est de retour sur terre. Il est devenu aveugle et son bâton impérial s'est transformé en une Croix. Avant de quitter définitivement notre monde et de gravir la « Grande montagne », il révèle à son fils, l'Empereur Nouveau, la connaissance qui permettra de rétablir l'ordre et de pacifier l'Empire : le repos du septième jour, ce jour que l'homme doit consacrer à Dieu pour lui « dédicacer » la terre[5].
Tout le second acte de la pièce se déroule en Enfer, au royaume des morts. Après d'hallucinants dialogues, d'abord avec sa propre Mère, puis avec le Démon, l'Empereur rencontre l'Ange de l'Empire qui lui révèle l'œcuménisme de l'ordre universel et lui transmet le « remède » pour sauver le « Royaume des vivants ». Enfin, dans le troisième acte, l'Empereur est de retour sur terre. Il est devenu aveugle et son bâton impérial s'est transformé en une Croix. Avant de quitter définitivement notre monde et de gravir la « Grande montagne », il révèle à son fils, l'Empereur Nouveau, la connaissance qui permettra de rétablir l'ordre et de pacifier l'Empire : le repos du septième jour, ce jour que l'homme doit consacrer à Dieu pour lui « dédicacer » la terre[5].
Le Repos du Septième Jour est la réponse longtemps attendue aux exigences de la conversion, une stase essentielle dans la vie de Claudel, si bien que l'on pourrait parler à son propos de « testament spirituel »[6]. Ce drame est l'acte de confirmation théâtral de sa conversion.
Ce n'est pas cependant l'aspect dramaturgique du Repos du Septième Jour qui a retenu l'attention des exégètes claudéliens. Ils se sont surtout intéressés à la pensée religieuse, au « drame d'étude »[7] où se retrouvent ses recherches théologiques et ses études sur la Chine. Ils ont analysé les rapports de Claudel avec Dante et saint Thomas d'Aquin, l'influence du paysage chinois et de la philosophie taoïste. Tout cela n'est pas sans intérêt mais il serait dommage de ne pas apercevoir l'expérience limite de la théâtralité que cette pièce propose.
Nous avons à faire avec Le Repos du Septième Jour à un texte dramatique qui transforme magistralement le projet du théâtre symboliste ; mais d'un symbolisme chrétien, de la Présence réelle.
La mise en œuvre de cette esthétique repose sur l'indication scénique liminaire du deuxième acte : « Obscurité complète ». À la fin de l'acte I, la terre s'est refermée sur l'Empereur. Sans aucune transition, sinon cette indication scénique, nous nous retrouvons aux Enfers où va se dérouler tout le deuxième acte. « Obscurité complète », la didascalie est en soi déroutante puisque le théâtre, en tant que spectacle, s'offre au regard. Theatron est le mot grec désignant le lieu d'où l'on voit l'action jouée, le drama. Or, n'oublions pas que, depuis les innovations techniques de Bayreuth, en cette fin du XIXe siècle, la salle et les spectateurs sont déjà plongés dans l'obscurité totale. L'importance de cette indication scénique est telle qu'elle ouvre la voie d'un contre-théâtre qu'il nous reste encore à découvrir. L'obscurité complète exigée par la didascalie efface la distinction des espaces sacré et profane, de la même manière que l'absence du rideau dans le théâtre chinois qui avait si fortement impressionné Paul Claudel.
Le poète a découvert le théâtre extrême-oriental dans le contexte de la Fête des Morts. Un poème de Connaissance de l'Est, intitulé « Théâtre » (daté de « Fou-Tchéou, mars-avril 1896 ») nous décrit l'architecture de l'espace scénique : « C'est, en retrait entre deux bâtiments, une terrasse de pierre : bloc haut et droit, et constituée de la seule différence de son niveau, la scène entre coulisse et foule, dont elle surpasse la tête, établit sa marche vaste et plate. Un toiture carrée l'obombre et la consacre comme un dais ; un second portique qui la précède et l'encadre de ses quatre piliers de granit lui confère la solennité et la distance. La comédie y évolue, la légende s'y raconte elle-même, la vision de la chose qui fut s'y révèle dans un roulement de tonnerre. Le rideau comparable à ce voile qu'est la division du sommeil, ici n'existe pas ».
Cette absence du rideau au théâtre pose la question du lieu de ce que Claudel appellera plus tard la « limite des deux mondes »[8], c'est-à-dire le lieu dramatique où se rencontrent le monde invisible-surnaturel, auquel appartient aussi le royaume des morts, et le monde visible-naturel qui est le nôtre. Pour Claudel, ce lieu dans le théâtre extrême-oriental se trouve situé dans le corps des acteurs, car la texture de leurs costumes est constituée de la matière même du rideau absent, ainsi qu'il l'exprime métaphoriquement dans son texte « Théâtre » : « Comme si chacun y [du rideau] arrachant son lambeau, s'était pris dans l'infranchissable tissu, dont les couleurs et l'éclat illusoire sont comme la livrée de la nuit, chaque personnage dans sa soie ne laisse rien voir de lui-même que cela dessous qui bouge [...] » Les acteurs revêtus des lambeaux du rideau sont à la « limite des deux mondes ».
Le théâtre classique chinois confirme donc les conceptions symbolistes de Paul Claudel : la scène est une « frontière »[9] où l'être du monde surnaturel survient dans le corps de l'acteur.
De même n'y avait-il pas de rideau dans le théâtre de Dionysos et le lieu et la frontière entre l'invisible et le visible correspondait à l'eskêné. Le rideau n'apparaîtra qu'au XVIIe siècle avec la scène à l'italienne.
Cependant le procédé de l'apparition du surnaturel se trouve en quelque sorte dédoublé dans Le Repos du Septième Jour. En effet la scène, plongée dans l' « obscurité complète » durant la totalité du deuxième acte, transforme l'espace en durée et la parole dont l'acteur est porteur se transpose dans le corps du spectateur qui devient lui-même l'espace scénique à partir d'un processus qui évoque la « composition de lieu » ignatienne.
Ignace de Loyola utilise pour la première fois l'expression « composition de lieu » dans l'énoncé 47 de ses Exercices Spirituels dont le but est de remettre en ordre les passions de l'âme afin d' atteindre le salut dans la connaissance directe de Dieu[10]. Il écrit que « [cette composition de lieu] consiste à voir par le regard de l'imagination le lieu matériel où se trouve ce que je veux contempler ». On rappellera que le cinquième exercice ignatien est la contemplation de l'Enfer dont la composition consiste à mettre « devant les yeux de l'imagination la longueur, la largeur et la profondeur de l'enfer ».
Dans Le Repos du Septième Jour, Claudel a dramatisé l'art jésuite de la Contre-réforme d'une façon demeurée jusqu'à nos jours inouïe. Durant l'audition de tout le deuxième acte, le spectateur est un exercitant qui visualise à l'intérieur de lui-même l'espace infernal au fur et à mesure qu'il est décrit par l'Empereur. Le spectateur-exercitant ne peut que procéder ainsi puisque l'enfer du Repos n'occupe aucun espace, il est vide, absolument indéfini.
Les premières paroles de l'Empereur descendu aux enfers en témoignent :
« L'Empereur : [...] Ah ah ! où, où suis-je ? Rien, dans la nuit compacte./ Point de gauche, point de droite, ni haut, ni bas, /Devant, derrière,/ Rien, nulle part. »
C'est que, de cet enfer qu'il explore, l'Empereur se révèle en quelque sorte le « complice », car il s'agit moins du pays des morts que de l'univers du péché auquel tout homme, depuis la faute originelle, appartient. Le Démon le rappelle clairement : « la punition est l'image de la faute ». L'enfer est intérieur et ce que l'Empereur découvre dans l' « obscurité complète », c'est sa propre conscience, son propre enfer. Ces considérations nous ramènent aux Exercices spirituels de Loyola et, plus particulièrement à ce fameux énoncé 47 de la composition de lieu où Ignace prend bien soin de remarquer que « Si au contraire [d'une réalité corporelle] est scrutée une réalité incorporelle comme est la considération des péchés, la construction du lieu pourra être d'imaginer que nous voyions notre âme enfermée dans ce corps corruptible comme dans une prison ». C'est bien ce qui se produit dans l'Enfer du Repos : dans l' « obscurité complète » se produit une véritable incorporation de la scène (eskéné) par le spectateur, plongé dans le noir et rendu aveugle, et dont le corps devient comme une caisse de résonance de la parole proférée. Le Verbe est mangé, manduqué. L'espace scénique s'intériorise en l'âme de chaque spectateur. Nous assistons au cérémonial eucharistique de la Présence réelle. On ne peut s'extraire de la représentation théâtrale que par l'irruption de l'invisible dans le visible.
L'ancienne religion chinoise se représentait la terre comme un carré surmonté par le ciel comme par un dais que soutenaient des colonnes. On aura remarqué la similitude architecturale entre l'espace scénique et l'espace cosmique. Nous pouvons dire que, selon cette vision, le théâtre est une image du monde, qu'il constitue par sa nature même un des plus parfaits symboles de la manifestation universelle.
Cette construction cosmique possédait des portes par où le soleil apparaissait et disparaissait. La Chine était située « au milieu » et la capitale était supposée au point central idéal. Or, quand débute Le Repos du Septième Jour, nous apprenons par la voix du Premier ministre que l'Empereur a quitté sa capitale et qu'il a choisi de résider dans un lieu où se trouve « la sépulture de l'Antique-Empereur », Hoang-Ti. Il y a une corrélation intime entre l'ordre cosmique et l'ordre social ; et l'invasion des morts correspond à une catastrophe surnaturelle qui équivaut à la perte du Centre métaphysique. Au troisième acte, au retour des Enfers, l'espace est restauré par la Croix et la terre redevient un lieu sacré, liturgique :
« L'Empereur : Regardez tous ! voici ce que je rapporte ! je tiens entre mes mains le signe royal et salutaire ! Voici la sublime intersection en qui le ciel est joint à la terre par l'homme. Voici le jugement entre la droite et la gauche, la séparation du haut et du bas. Voici l'oblation et le sacrifice ! Voici le très-saint Milieu, le centre d'où s'écartent également les quatre lignes, voici l'ineffable point. Considère ce signe, ô monde ! »
Le retour du tragique surgit ainsi du Centre retrouvé. Lorsque l'Empereur reparaît parmi les vivants, au troisième acte, on voit à quel point l'épreuve de l'enfer et sa victoire sur la tentation l'ont transformé. Il se présente alors le visage couvert d'un masque, le masque de la tragédie antique. Quand il l'ôte, à la demande de son fils, on découvre qu'il n'a plus de visage. Son visage est celui de chaque spectateur. La conversion du regard a eu lieu, réalisant la conception symboliste d'un contre-théâtre : le théâtre du septième Jour.

(1) « Ma conversion », in Œuvres complètes (OC), XVI, Gallimard, p. 190.
(2) Il a lu Vestiges choisis, le « fameux livre du Père de Prémare », savant jésuite du dix-huitième siècle qui composa ce gros recueil de citations tirées de la littérature chinoise pour prouver cette révélation.
(3) « Pagode », « Fête des Morts le septième mois » et «Tombes-Rumeurs ».
(4) « La grande leçon que m'a donnée Mallarmé [...] consiste en ces mots : " Qu'est-ce que cela veut dire ? " ». Mémoires improvisés, Gallimard, 1954, pp. 64-65.
(5) Au sens religieux et étymologique qui signifie la consécration d'un lieu. Du latin dedicatio.
(6) Jacques Houriez dans sa précieuse édition critique de 1987, adaptation d'une thèse préparée sous la direction de Jacques Robichez.
(7) Ainsi que Claudel a qualifié sa pièce dans les Mémoires improvisées, op. cit., pp.147-149.
(8) Expression qu'il emploiera pour la première fois en 1910 dans Les Superstitions chinoises, in Œuvres en prose, Gallimard, 1965, p. 1082.
(9) Terme qui n'apparaîtra dans le théâtre claudélien qu'à partir de La Femme et son ombre, écrit au Japon en 1922.
(10) Cf. Pierre-Antoine Fabre, Ignace de Loyola, le lieu de l'image, Vrin, 2002.
 Imprimer
Imprimer
Commentaires
Pour que le rideau s'ouvre, peut-être faut-il d'abord que le Christ meure sur la croix. Pour que notre spectacle commence, le rideau ne s'ouvre pas, il se déchire. Le théâtre Chrétien est un théâtre de trois jours, d'entre deux, du temps qui sépare la mort de la résurrection. Il faut s'y inscrire.
Écrit par : MF | jeudi, 19 novembre 2009
Lors des Dionysies, la partie strictement théâtrale durait 3 jours. Je vous remercie d'avoir lu mon article.
Alain Santacreu
Écrit par : Alain | vendredi, 20 novembre 2009
"Je vous rends grâce, Seigneur, non pas à cause de moi, mais à cause de Vous-même!"
Paul CLAUDEL, in La Messe là-bas.
Écrit par : Jean-Marie MATHIEU | mardi, 08 décembre 2009